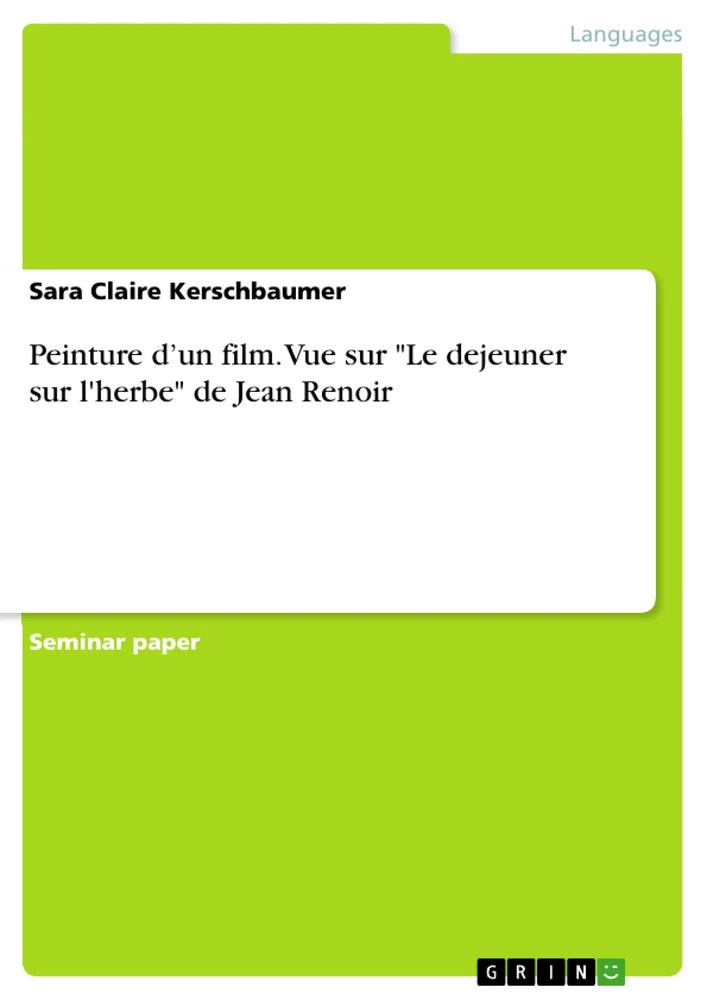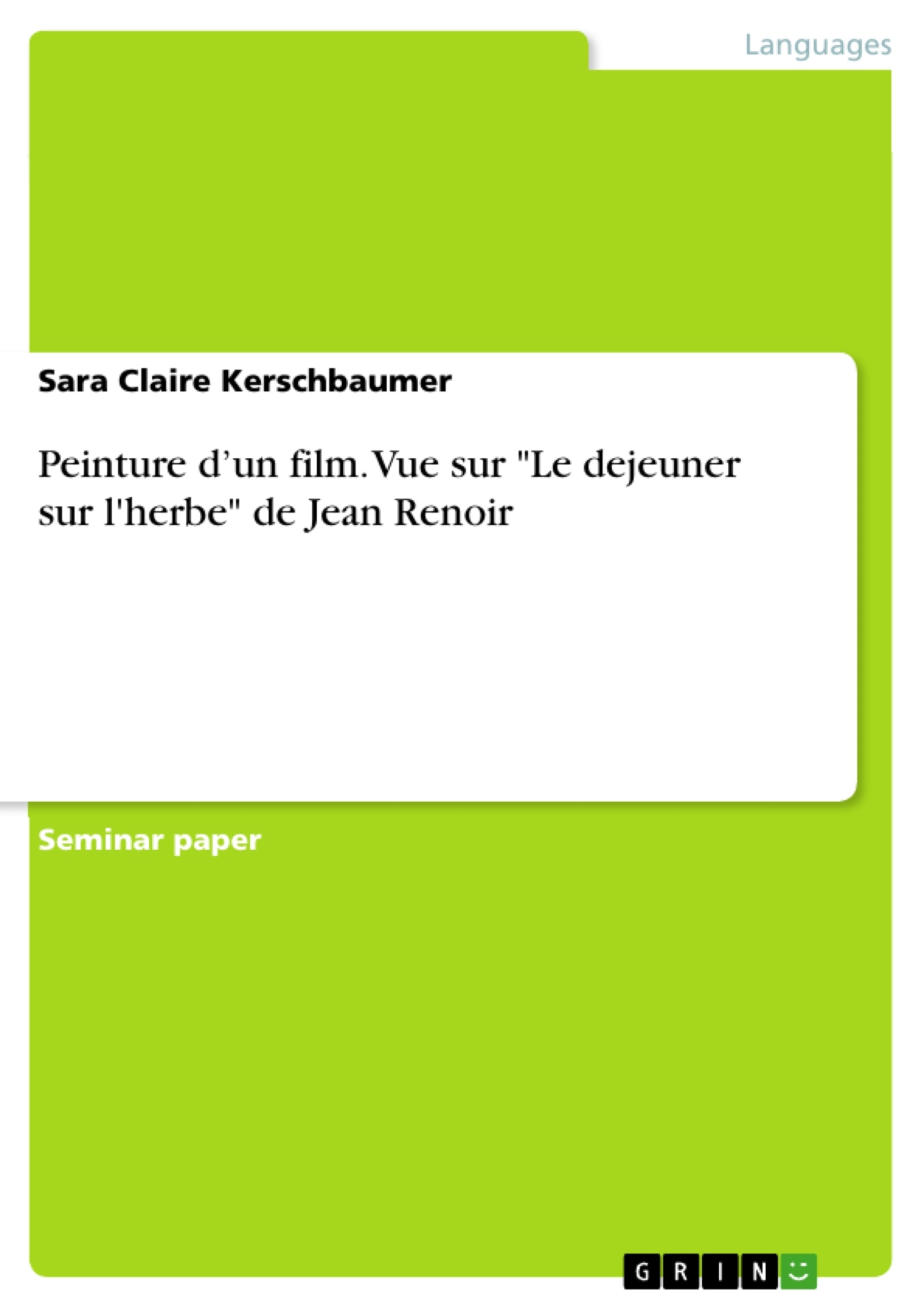Filmananlyse zum Werk Jean Renoirs, zum Einfluss der Malerei (Vater: Maler Renoir), der Musik, der Opposition Natur7Technik und der Aspekt des Filmographie; des quasi testamentarischen Vermächtnisses in einem seiner letzten (Farb!-)Filme.
Titre: Peinture d’un film.
Vue sur Le déjeuner sur l’herbe
de Jean Renoir
Table
Introduction p.3
I. La réalisation du film p.4
I.I.i. Fiche technique p.4
I.I. Le tournage p.4
I.II.i. La Distribution/ Les acteurs p. 5
I.II. Au tour des acteurs et personnages p.6
I.II.I Nénette p.6
I.III Les espaces p.8
II. Une œuvre pour les sens, un hommage à la peinture p.11
II.I Manet et Renoir p.11
II. II. Enchanter les images par la musique p.12
II.II.I Le rôle du son p.14
Conclusion
III. Le monde apolloniens et l’esprit dionysiaque p.15
III.I L’Harmonie et l’opposition p.16
Bibliographie p.17
Table des Illustrations p.18
Table
Introduction
I. La réalisation du film
I.I.i. Fiche technique
I.I. Le tournage
I.II.i. La Distribution/ Les acteurs p. 5
I.II. Au tour des acteurs et personnages
I.II.I Nénette
I.III Les espaces
II. Une œuvre pour les sens, un hommage à la peinture
II.I Manet et Renoir
II. II. Enchanter les images par la musique
II.II.I Le rôle du son Conclusion
III. Le monde apolloniens et l’esprit dionysiaque
III.I L’Harmonie et l’opposition
Bibliographie
Table des Illustrations