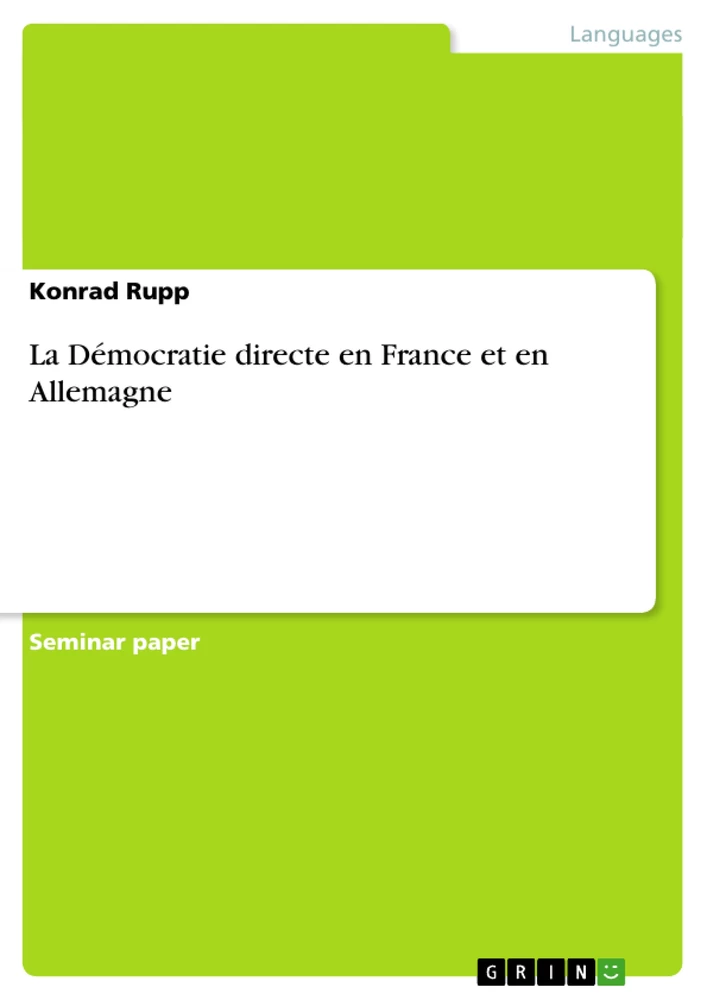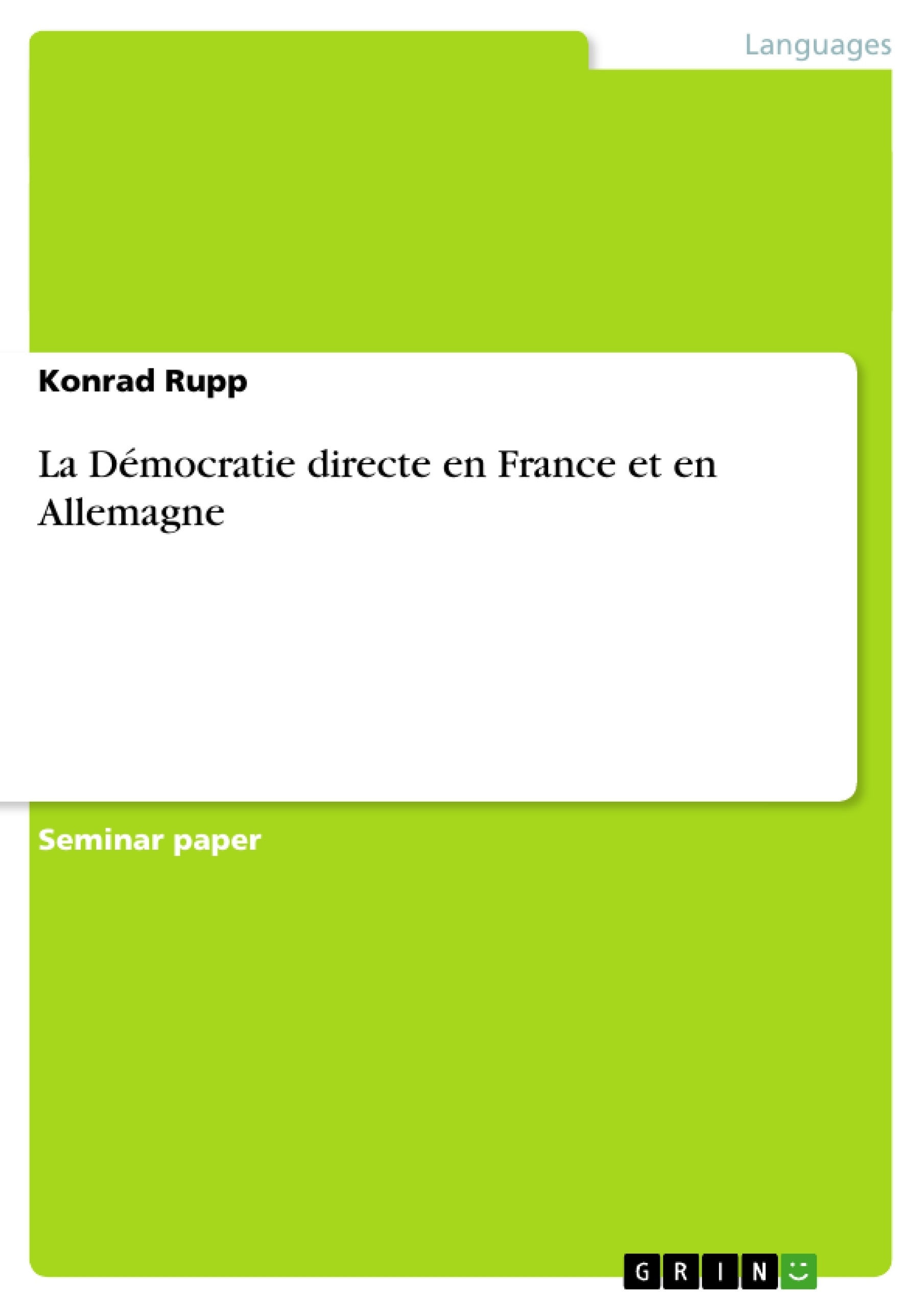L’Histoire de la France est basée sur la démocratie. Depuis la Révolution de 1789, la France est le premier pays d’Europe à nommer lorsqu’on parle de démocratie ou de principe de souveraineté du peuple.
Mais le souvenir le plus récent n’est pas si bon : le 29 mai 2005, les Français rejetèrent le projet de Constitution européenne par référendum. Cela a signifié un revers pour l’Union européenne et aussi pour le gouvernement français. Mais en même temps, cela a permis aux Français de prouver leur désaccord vis-à-vis de leur gouvernement.
D’une part, ce référendum représentait un exemple de l’utilisation d’éléments de démocratie directe. D’autre part, il montrait aussi clairement les problèmes qui apparaissent si, par exemple, les citoyens manifestent leur mécontentement du gouvernement par leur vote.
J’introduirai tout d’abord les termes les plus importants concernant la démocratie directe, et je les définirai. Puis je démontrerai les arguments pour et contre la démocratie directe. Je mettrai l’accent sur les chances qu’offrirait la démocratie directe.
Dans la partie suivante, j’aborderai la situation actuelle en France, et notamment les lois concernant la démocratie directe, l’utilisation et le succès de certains éléments de la démocratie directe. Après une étude similaire de la situation en Allemagne, je comparerai la France et l’Allemagne avant de déterminer les deux pays en Europe.
Les questions centrales de mon mémoire sont les suivantes : la démocratie directe est-elle possible en France et en Allemagne ? Et si oui, à quel point ? Est-elle utilisée souvent et comment s’en tirent les deux pays avec elle en comparaison avec d’autres pays européens ?
Sommaire
1. Introduction
2. Définitions
3. Pour et contre la démocratie directe
4. Démocratie directe en France
4.1. La loi
4.2. L’utilisation / Le succès
5. Démocratie directe en Allemagne
5.1. La loi
5.2. L’utilisation / Le succès
6. Démocratie directe - Une comparaison de pays
6.1. France - Allemagne
6.2. Le contexte européen
7. Conclusion
8. Littérature
1. Introduction
L’Histoire de la France est basée sur la démocratie. Depuis la Révolution de 1789, la France est le premier pays d’Europe à nommer lorsqu’on parle de démocratie ou de principe de souveraineté du peuple.
Mais le souvenir le plus récent n’est pas si bon : le 29 mai 2005, les Français rejetèrent le projet de Constitution européenne par référendum. Cela a signifié un revers pour l’Union européenne et aussi pour le gouvernement français. Mais en même temps, cela a permis aux Français de prouver leur désaccord vis-à-vis de leur gouvernement.
D’une part, ce référendum représentait un exemple de l’utilisation d’éléments de démocratie directe. D’autre part, il montrait aussi clairement les problèmes qui apparaissent si, par exemple, les citoyens manifestent leur mécontentement du gouvernement par leur vote.
J’introduirai tout d’abord les termes les plus importants concernant la démocratie directe, et je les définirai. Puis je démontrerai les argument pour et contre la démocratie directe. Je mettrai l’accent sur les chances qu’offrirait la démocratie directe.
Dans la partie suivante, j’aborderai la situation actuelle en France, et notamment les lois concernant la démocratie directe, l’utilisation et le succès de certains éléments de la démocratie directe. Après une étude similaire de la situation en Allemagne, je comparerai la France et l’Allemagne avant de déterminer les deux pays en Europe.
Les questions centrales de mon mémoire sont les suivantes : la démocratie directe est-elle possible en France et en Allemagne ? Et si oui, à quel point ? Est-elle utilisée souvent et comment s’en tirent les deux pays avec elle en comparaison avec d’autres pays européens ?
Malheureusement, il n’est pas possible de faire la distinction satisfaisante entre les différents échelons (national, régional, communal) dans le cadre d’un mémoire, étant donné la multitude de lois de décrets différents.
2. Définitions
On définie la démocratie directe comme un acte de déclenchement politique des décisions par le peuple, un acte qui introduit un acte de décision au
и
suffrage universel[1]. La démocratie directe est considérée comme la démocratie moderne. Néanmoins, l’idée que les citoyens d’un pays puissent participer directement aux décisions du gouvernement est très ancienne.
Il y a plusieurs formes ou mécanismes de démocratie directe. Ainsi, on distingue les formes où le gouvernement doit, selon la constitution, laisser voter le peuple (référendums obligatoires), où le gouvernement initie volontairement un référendum (référendum facultatifs), les plébiscites et le cas où les initiateurs d’un référendum font partie du corps électoral : l’Initiative populaire[2].
Le référendum est défini comme un « vote de l’ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif[3] ». Des référendums obligatoires s’utilisent si la constitution ou les lois d’un pays obligent le gouvernement de les initier. C’est le cas dans beaucoup de pays pour des décisions de révision de la constitution. En revanche, les motifs pour un référendum facultatif sont plutôt politiques si, par exemple, le gouvernement veut assurer plus de légitimation pour un projet de loi[4]. De plus, on peut distinguer le référendum consultatif du référendum décisionnel. L’un a le caractère d’un conseil pour le pouvoir exécutif, l’autre remplace une décision. Une plébiscite est, en revanche, le vote « du corps électoral sur la confiance (Г qu’il accorde à la personne qui a pris le pouvoir[5] ». Le référendum diffère du plébiscite dans la mesure où l’un se rapport à des mesures et l’autre à des personnes.
L’initiative populaire est comprise comme « pétition de masse[6] » . Elle n’est alors qu’une proposition au législatif pour discuter un sujet. Un référendum peut bien-sûr succéder à cette proposition.
Pour limiter le nombre d’initiatives populaires, il existe quelques obstacles pour freiner les initiateurs. Ainsi, il faut prendre en compte l’exclusion de matières, le nombre fixe de signatures pour que la pétition soit étudiée, le délai pour rassembler assez de signatures ou encore le quorum. Le quorum est soit le nombre de citoyens qui participent au référendum soit le nombre de citoyens qui votent « pour ».
[...]
[1] Cf. Melanie Walter-Rogg, « Direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und im internationalen Vergleich », in Oscar W. Gabriel (Éd.), Politische Partizipation, www.politikon.org/inhalt, 2003, p. 6.
[2] Cf. ibidem, p. 11 suiv.
[3] Paul Robert, Nouvelle édition du Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2007, p. 2158.
[4] Cf. Melanie Walter Rogg, op. cit., p. 11 suiv.
[5] Paul Robert, op. cit., p. 1930.
[6] http://bb.mehr-demokratie.de/fileadmin/md-bb/pdf/leitfaden_volksbegehren.pdf, p. 5.